Unpaultitled

Alors, quoi faire ? Que dire ?
Pas de disque bouleversant à interpreter, pas de films renversants à tenter de traduire en mots , pas de lecteurs pour ce blog de toute façon, plus d'espoir pour cela comme pour tout, pas de vie à raconter.
Je devrai rester silencieux. Et le fait que je ne suis pas ce conseil prouve qu'il reste en moi une petite étincelle d'espoir. Vraiment fine, chancelante, soufflée par le vent des idées noires de la réalité. Dans ces conditions, il s'agit sans doute d'un post isolé, une vaine tentative de renouer à ce qui pouvait me donner du plaisir avant.
Intéressant, d'ailleurs... Pourquoi blogger sur des choses et d'autres pouvaient me donner du plaisir il y a quelques années et ne le fait plus aujourd'hui ? Je pourrai arguer comme précédemment que tout est la faute de la médiocre production artistique actuelle sur laquelle j'ai de plus en plus de mal à rebondir, trop déphasé, trop lassé. Mais pourtant, j'aurai pu écrire sur, entre autres, pourquoi "The Wire" est une série shakesperienne tandis que les "Sopranos" n'aurait sans doute pas été renié par les surréalistes, voire les absurdes et tout ce courant discontinue qui traverse le 21ème siècle. J'aurai pu le faire mais je ne l'ai pas fait, faute de véritable envie, faute d'y voir une récompense. Alors je voyais sans doute dans l'écriture d'un blog (et, allez, l'écriture dans sa globalité), quelque chose que je n'y vois plus. Peut-être une mise en valeur de moi-même, de mes idées. Le fait qu'être lu, compris ou débattu pouvait être une récompense. Mais la patience s'use. Les débats dans le vide, je peux les faire sans internet, j'en ai l'habitude. La blogosphère est trop occupé à s'auto-citer, à name-dropper, à critiquer, à loler, et à essayer de gagner de l'argent avec googleads, pour se pencher sur moi.
Alors oui, c'est sans doute ça (et le fait que je devienne plus bête d'année en année). Je n'ai pas besoin du net pour être seul. La vie est suffisante. Enfin la vie ... Quelqu'un pourrait-il me définir ce qu'est vivre ? Ou bien au moins m'expliquer comment on fait. Je n'en ai vraiment aucune idée. Oh, parfois j'essaie, en vain. Ou alors je n'y prends aucun plaisir. C'est étrange, n'est-ce pas ? C'est comme ça, je n'y peux pas grand chose. Peut-être que j'ai une vie, mais il n'appartient qu'à moi. Aucun espoir de la partager, aucun moyen de faire en sorte qu'elle consiste en partager quelque chose, communiquer avec quelqu'un.
Je suis quelqu'un de bien pourtant, je crois. Qu'est-ce qu'un monde qui ne réserve rien aux gens qui essaient d'être gentils ? Un monde où tout et tous sont similaires, spécialement ceux qui crient le plus fort qu'il ne le sont pas.
Ce post n'avait vraiment aucun intérêt.
Message à durée limité
Information qui ne restera pas très longtemps ici :www.allendtomorrow.canalblog.com
J'en ai assez d'y être seul, même si ma solitude est dans la tête.
Si vous m'avez aimé une fois, quelques instants, allez-y. Peut-être pourriez-vous retomber amoureux encore, d'un mot, d'un son. Pas trop longtemps bien sûr. Vous pourriez vous lasser, ou pire, vous réveiller.
Et quand vous y serez, pourquoi ne pas me le faire savoir ?
Comme des chiens désespérés fouillaient la terre

Je marchais dans la rue, simplement, quand un garçon me prévient : « attention, votre lacet est défait. Vous risquez de trébucher et de tomber ». Jeune, idiot, curieux. Je lui réponds « Si seulement ». Je réfléchis à la façon dont je vais commencer à le frapper. Je pourrai simplement le pousser en arrière à l’aide de mes deux bras et compter sur son inexpérience, sur la faiblesse de ses membres mal formés pour qu’il perde l’équilibre. Je pourrai le toucher une seule fois, avec mon poing, au beau milieu de son visage, sur le nez, et entendre ce craquement symptomatique qui amène le sang à s’épandre de manière impressionnante, un peu comme quand on manipule trop brusquement une bouteille de champagne et que sous l’excitation de la soirée de Noël, ou remplacez avec n’importe quoi de faux et de puant, la bouteille se brise et que la boisson forme une bave blanche qui entache le sol et pénètre la moquette comme un pauvre mousseux un soir de disette, un soir de solitude, un anniversaire raté où tous les invités ont oublié de venir parce qu’ils n’étaient tout bonnement pas invités. Ou encore je pourrai, mais là ce serait risqué, lever une de mes jambes douloureuses, me pencher très légèrement en arrière, essayer de maintenir mon équilibre le mieux possible, juste quelques secondes, juste le temps d’étendre ma jambe et qu’il sente et que je sente mon pied pénétrer entre ses côtés, les écarter, les soulever, jusqu’à toucher ses organes vitaux, dans le rapport le plus intime que nous n’aurons jamais, le rapport le plus intime qu’il ait connu avec une personne vivante, un être humain, sur terre, lors d’une si simple fin d’après midi d’avril, quelques secondes avant de mourir. Ensuite, quoi qu’il arrive, il serait déstabilisé, à de degrés divers, et je n’aurai plus qu’à enchaîner, sans même avoir à le choisir, sur le coup de grâce, peut-être que je prendrais son visage et que je l’enverrai s’écraser plusieurs fois de suite contre la façade dure et irrégulière de l’immeuble gris au pied duquel nous nous sommes croisés, de sorte que s’il ne meurt pas sous les coups, il finisse étouffé par les morceaux de béton que son crane aura lui-même détaché de la façade ; peut-être que je le finirai avec mes pieds, quand il sera à terre, profitant enfin pleinement des bouts pointus et durs de ses chaussures de luxe qui ont contribué à vider mon compte en banque ; peut-être qu’avec mes deux pouces, j’appuierai sur sa gorge pendant que mes mains retiendraient son visage et qu’avec ses yeux de plus en plus exorbités il me regarderait avec un air de pitié qui survivrait malgré tout, malgré la mort, à la douloureuse expulsion de ses globes oculaires hors de leurs cavités ; peut-être que je l’épargnerai. Ce serait un pari. Un pari sur la crédulité et la miséricorde du système. Je mise contre, bien entendu. Avec ce que je lui aurai déjà fait, je serai bon sur la prison bien entendu. Reste à savoir pour combien de temps. Quitte à gagner, autant mettre toutes les chances de mon côté. Je l’achèverai et j’appellerai moi-même la police. Je veux de la prison. N’importe où hors de ce monde. Alors pourquoi pas là ? J’ai 50 ans et j’en fait au bas mot quinze de plus. Avec un meurtre, agrémenté de violence aggravée, une peine de 30 ans me laisserait sans doute une marge assez grande pour crever. N’importe où, alors c’est là que je veux aller. Précisément là, et n’importe où . Dans une cellule, isolé, seul, sans rien d’autre que de toilettes, une table, un lit, impossible de sortir, impossible d’être traîné au dehors, à l’air frais, impossible de se retrouver dans la beauté des rues un matin d’été, même pas par le plus grave des malentendus. N’importe où, c’est là. Exactement là. Rien d’autre que moi, mes organes et mon cerveau. Mes souvenirs, mes regrets qui s’effaceront peu à peu. L’imagination qui prendra le dessus. La folie, la folie pure. N’importe où loin des autres. Et je me rends compte que le temps qu’il me faut pour étudier ces différentes façons de le tuer, il reste immobile face à moi pendant que je le dévisage, et c’est sans aucun doute le temps le plus long que je prends pour observer un être humain depuis des siècles, des millénaires peut-être, bien avant que les momies ne soient que des tas de cendres durcies, bien avant que le monde ne soit monde et que moi, d’hier, devienne moi, d’aujourd’hui. Et d’un coup, le temps me rattrape. Je ne fais rien pour le tuer. Je ne peux tout bonnement rien faire. Je n’arrive qu’à penser, à imaginer, impassible, impuissant, maudit, un vieil homme aigri, un imbécile fini, voilà tout ce que je suis, et c’est seulement à cet instant précis que je m’en rends compte. Cet instant précis où, pour tout avouer de la douleur, le garçon en face de moi enfonce son pied dans mes côtes. Trop tard pour espérer réagir, j’avais mis déjà tant de temps pour réfléchir, comment aurai-je pu contre-attaquer ? Dans n’importe quelle situation, comment aurai-je pu le devancer, comment aurai-je pu effectuer le moindre mouvement de mon corps meurtri que je ne reconnais plus, comment aurai-je pu retourner le temps comme je tourne dos à la vie ? Qu’ai-je été stupide de croire en mes vieux réflexes, d’écouter ces voix autrefois si fidèles qui désormais me mentent, cherchent ma perte, trompent mon jugement, me détournent et m’amènent aussi vite que possible vers la mort. C’est un combat entre elles et moi. Je dois, JE DOIS, vivre et leur donner tort. Quel autre choix pour justifier mon existence et ces années sans cela perdues ? Je ne sais pas qui je suis aujourd’hui, je ne suis pas sûr de qui j’ai été avant, mais je sais que ce « je », ce « il », cette chose que je suis, doit survivre pour gagner. Ce n’est plus une question de réussir ni même d’être heureux. Il s’agit, simplement, de justifier une vie. Justifier toutes ces années que j’ai passé à espérer et à respirer et à continuer. C’est pour cela qu’à terre, brûlé jusque dans mes yeux par la douleur, je ne peux qu’admettre ma défaite. Mais si la terre est ordinaire, le destin est un chien enragé accroché à mon pantalon. Ce garçon, plutôt beau, les cheveux courts, les muscles bandés, la peau fine renforcé par l’expérience d’une brute, que je ne pouvais qu’imaginer étant moi-même sur le ventre, le visage contre le sol, s’arrête de me frapper. En fait, il ne m’a frappé qu’une seule et unique fois et se tient immobile, derrière moi. Il m’observe sans doute, attendant ma réaction. Je peux sentir ses yeux sur moi. Que faire d’autres que reprendre mon souffle ? Qu’attend-il de moi, je m’appuie sur mes jambes, étire mes orteils et me lève en soutenant mon corps de mes mains. Est-ce ce qu’il veut ? Qu’ai-je fait pour en arriver là ? Quel est l’objectif, le mien, le sien, notre rencontre ? Il ne bouge plus ou le fait sans bruit. J’en viens à croire, lui tournant toujours le dos, les mains recouvertes de graviers, que je l’ai imaginé. Je serai prêt à n’importe quoi pour me faire du mal. C’est pourquoi je ressens cet instant d’hésitation quand, au moment de me tourner, sa voix, devenue plus profonde, à moins qu’il ne soit simplement refroidi, trouble le silence. Lui ou mon inconscient ? « Vous avez déjà fait attention aux traces sur vos mains après que vous vous soyez relevé ? C’est comme les avoir abîmées au travail pendant des dizaines d’années. Comme si nos lignes de vies avait explosée, comme si nous n’avions plus d’avenir, plus de passé, mais simplement des milliers de cratères rouges pour trébucher et chuter. Et puis ils disparaissent si vite qu’ils en effacent presque le souvenir de cet éclair de lucidité. C’est le souvenir de la chute, chacune est une leçon, mais nous n’apprenons rien, nous ne sommes que des êtres humains après tout ». Il n’est plus seul. Derrière lui et à côté de lui, un petit groupe de quatre personnes lui ressemblant étrangement s’est amassé sans que je m’en rende compte un seul instant. Ils étaient même sans doute là depuis le début, tapis dans l’ombre ou dans son dos. La chose qui pourrait être drôle, et je ne sais pour quelle raison, je n’ai pas envie de rire, c’est qu’il n’a rien dit. Personne n’a prononcé la phrase que je viens d’entendre. Je le sais et je l’affirme parce qu’ils sont entrain de parler entre eux. Frémir par la bouche serait une description plus appropriée. Par moments, ils s’aboient presque dessus. Ils semblent en apparence avoir tout oublié de mon existence. Sauf que je comprends, en déchiffrant des bribes de dialogues, qu’ils se disputent pour se partager ma dépouille. Ils communiquent par des chuchotements entrecoupés d’hurlements, ils sont réunis en un cercle d’où n’échappent que certains de leurs membres, bras, têtes, quand ils expriment avec leurs corps le mécontentement ou l’approbation. Il n’y a plus d’issue. Je suis à leur merci. Je songe quelque seconde à faire un pas puis l’autre en arrière jusqu’à être assez éloigné pour partir en courant mais à peine l’idée me traverse l’esprit qu’ils arrêtent leur conciliabules et que l’une des sentinelles fait dépasser sa tête hors du cercle pour que j’oublie cette idée. On dirait des frères. Ils ne le sont sans doute pas. Ce doit être simplement leur vie communes, leurs idées communes, leurs déceptions et leurs joies communes, qui les ont forgé semblables, de la même manière qu’au fond, tous les êtres humains se ressemblent. Ils me semblent bien moins beaux désormais, et ils se révèlent plus jeunes encore que je ne le pensais la première fois que j’ai vu ce garçon. Ils doivent avoir 16 ou 17 ans au maximum. Je l’entends, lui, le premier, celui qui me mis à terre, dire d’une voix sans doute intimidante pour ses amis, et qui me semblent à moi terriblement juvénile et récitée : « C’est moi le chef du gang » et ça je suis sûr qu’il l’a prononcé. Profitant de mes instants de répits, je scrute les alentours, pas tant avec l’espoir de trouver quelqu’un pour me secourir, que pour admirer avec l’expérience des moments difficiles le paysage désolant qui m’entoure. Un flot de voitures qui nous dépassent en soulevant de l’air chaud, des immeubles décrépis qui était pourtant déjà terriblement moches à l’origine, des hommes de tout âge tout autour de nous, en face, à droite, à gauche. Pas de femmes. Ça me frappe. Pas une femme dans la rue. Je me dis que c’est tout ce dont j’aurais besoin, sans savoir pourquoi. Aucune ne m’a jamais sauvé, pourquoi maintenant ? Je n’ai jamais aimé personne et jamais personne ne m’a aimé. C’est comme ça. A ce moment précis je me pose sincèrement la question de savoir si je préfère mon égoïsme à toute forme de vie : vaudrait-il mieux que j’ai une femme et des enfants pour les pleurer et qu’ils portent mon deuil ou bien mon existence est-elle justifiée du fait de cette mort sordide qui m’attend et dont personne ne souffrira, personne si ce n’est moi. Et encore. Pourrai-je me défendre ? Impossible. Je n’argumente même pas et je n’argumenterai pas. Je les laisserai m’exécuter parce que c’est ainsi que ça doit finir. Un peu moins d’espoir. Pas de maladie. Pas plus d’ennui qu’il n’y en eut. J’aimerais les tuer bien sûr. Ça pourrait même me provoquer du plaisir intense. Toute ma vie j’ai voulu tuer quelqu’un. J’ai attendu. Au début, je l’avoue, je ne voulais pas la prison. Je ne voulais pas inventer un stratagème pour me disculper du meurtre, ou pire, ne pas y être lié. Je voulais être coupable et je voulais des circonstances atténuantes. Je voulais que l’on reconnaisse mon droit à tuer ne serait-ce qu’une seule personne en paiement du reste. Et en vieillissant j’ai appris à vouloir ma peine, à l’attendre, à la chérir. Mais j’ai toujours été trop honteux, j’ai toujours trop attendu le bon moment pour passer à l’acte et l’occasion se présentant à moi, aujourd’hui je n’ai plus la force de la faire. En un furtif instant je crois voir apparaître les cheveux d’une femme dans une voiture qui file et déjà n’est plus qu’un point à l’horizon. Je n’ai jamais tué et je n’ai jamais aimé. Que me reste-t-il de la vie. Rien, que dalle. La solitude. Moi. Plus pour longtemps. Je me suis persuadé, à un certain âge, pas vraiment longtemps après l’adolescence, que l’amour était comme un meurtre. Je voulais atteindre mes deux buts en même temps. Et j’y crois encore, bien que mes buts restent vides et vains. Par l’amour, on se tue soi-même. C’est comme un meurtre perpétuel où l’on cède, où l’on donne son intégrité à un autre, où l’on accepte mutuellement d’arracher ses croyances, ses espoirs, sens envies et ses rêves, non pour prendre ceux des autres, mais pour le grand vide, le rien du tout, le néant. Il était impossible d’atteindre mes deux buts à la fois parce que dans le principe et dans l’esprit, ils étaient contradictoires et que dans la réalité, ils étaient semblables. Des gens comme moi ne peuvent comprendre ni accepter ce genre de vérité. Des larmes viennent troubler mes yeux alors que je repense à toutes ces choses que j’avais depuis longtemps rangé, classé, et caché. Alors que je ne vois plus rien, la voix du jeune homme, soutenu par ces amis, retentit à nous : « Nous n’acceptons rien non plus. Nous ne comprenons rien, comme vous. Le sexe n’est qu’une drogue douce, c’est un joint, on se sent bien et chaud, on a confiance en nous alors qu’au fond on se comporte comme de grosses bêtes idiotes ». Je les sens se mouvoir, le cercle se déplace, change de configuration et s’approche de moi. Saisi de panique et de dignité, je sèche et retiens mes larmes. Ma vision retrouvée, impossible de savoir si c’est vraiment eux qui viennent de parler, ils sont muets, me regardent presque avec pitié, comme des spectateurs face à moi tandis que le premier jeune homme s’approche et me prend par le col. Je trouve si bizarre d’entendre des voix. Ça ne m’était jamais arrivé, à part peut-être certains matins alcoolisés trop fréquents, seul dans la chaleur étouffante de mon lit. Il sort une arme de sous sa veste et la tend juste sous mes narines de telle sorte que mon propre souffle pénètre le canon et me revient instantanément après avoir buté sur la balle qui m’attend. Par fait de hasard, il n’y a plus de voiture et plus personne dans la rue. Ces acolytes surveillent tout de même les alentours mais lui ne semblent même pas inquiété. Je me sens vieux, si vieux, que l’idée de la mort ne me semble plus farfelu. Quand le pistolet ne me lâche plus du regard, le groupe se ressert et les spectateurs oublient tout des alentours. A quel moment ai-je arrêté de me défendre ? A quel moment aujourd’hui, et à quel moment bien plus tôt, dans mon histoire. Est-ce parce que je n’avais plus la force ou est-ce parce que j’ai arrêté que j’ai perdu toute force ? L’arme posée sur ma tempe, le jeune homme prend un dernier souffle comme pour partager ma peine et je réalise une chose qui me paraît très importante à prendre en compte : je suis encore saoul d’hier. Et j’attends le Cling Bang. Clic.
Poèmes pourris II

Il avait coutume de
Dire,
Je veux
Mourir en montant, le vieil homme,
Quand il était
Encore jeune,
C’est ce qu’il disait,
Mourir à Montmartre,
Mourir en un acte
Tout oublier du passé,
Pas à pas crever,
C’est ce qu’il souhaitait,
Quand il avait 20 ans,
Tantôt livreur, serveur, tueur,
Trop tard amoureux, pianiste,
Libre,
Ce sacré vieillard, juste là
Sous mes yeux,
C’était milles vies qu’il vivait,
Autant de marches qu’il y avait,
Je vais où je vais,
Qu’il disait,
Tant qu’il y en aura j’irai,
Qu’il disait,
Qu’aurai-je bien pu faire,
C’était pathétique,
Quand ses pas s’arrêtèrent,
A la renverse, la tête à l’envers
Jusqu’à ce que le sang verse,
Qu’aurai-je pu faire d’autre,
Quand il redescendait,
Que de courir et dire,
Je veux mourir en montant,
Crever dans les escaliers,
Au moins essayer.
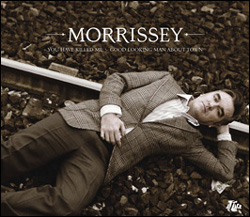
On m’a tué
Ce n’est pas ma faute
J’ai cédé devant la somme
De ses sons
Comme un assommoir,
Entêtante, en tête
De liste de
Mes bêtises,
Bête, lisse,
Elle m’a tué,
La faute à personne,
Mis mon cœur en hélice,
Ma gorge en cendrier,
Avec bonheur,
C’était mon heure,
La faute de personne,
Pauvre petite joueuse de
Guitare, je lui disais combien
j’aimais ses doigts, il était si tard,
trop tard, assez tôt pourtant
pour encore pouvoir les sentir,
là autour de mon cou,
comme un cadeau, un au revoir,
je les aimais tant et elle répondait,
en citant faux comme avant,
on aime ce que l’on détruit,
ô combien je souhaite son erreur vraie,
ô combien elle m’aimerait,
la belle est cruelle,
belle et cruelle.
TheHorrorTheHorror

Pourrons-nous un jour retrouver ce qui a été perdu ? D’abord décontenancé à tendance déçu par le happy end, je commence à peine à esquisser un doute, me demander si finalement ce n’est pas possible, rien que dans l’esprit, après plein de péripéties. Mais je n’en sais rien, c’est bien sûr pour ça que nous allons chercher ensemble.

Au fur et à mesure, je me suis posé cette question : est-ce possible pour une fille (je suppose que ça vaut aussi pour un homme mais, ce n’est pas ça que je regarde), d’être très laide au naturel et splendide en souriant ? De la réponse positive à cette question est née une faille qui grandira jusqu’à ébranler l’édifice de mes croyances morbides.

Donc, nous pouvons être deux choses alternativement. Pourtant chacun de ces deux visages existent en même temps, partagent les mêmes muscles, la même peau, ils se préexistent l’un à l’autre. La beauté ne se perd pas, elle survit même aux pires années de malheur pour ressurgir fraîche, à partir de ce qu’avait construit le malheur. La beauté n’est pas perdue. Le malheur non plus. Si je me prends en exemple, je suis deux presque chaque jour. Il y a moi et il y a Paul Austère, celui qui signe ces posts. Je suis ces deux personnes de manière alternative, je suis moi quand je vis et parle, je suis Paul quand j’écris. Parfois même ils cohabitent, je vis et respire tandis que Paul écrit déjà dans mon cerveau, attendant le moment fatidique où je déciderai d’attraper un stylo et de lui laisser le contrôle. Il est assez fort pour que ça arrive assez souvent, sous peine d’explosion. Il n’est pas assez fort pour être tous le temps présent et en dehors de l’écriture et j’en suis vraiment désolé. Si vous me connaissiez, vous seriez tellement tristes. Déçus. Je ne suis pas Paul Austère, je ne suis pas ces mots et ces paragraphes, ces blogs et ces romans. Je ne peux l’être. Mais peut-être l’ai-je été et mon seul espoir est de croire que ce qui a été perdu peut être retrouvé.

Je suis pressé et Paul Austère ne l’est pas. Il est triste et je suis euphorique. Je suis perdu et il est ailleurs. Il est beau et je suis horrible. Je parle trop pour ne rien dire et il dit peu pour séduire. J’ai peu d’esprit et quelques connaissances et lui peut tout rien que par la réflexion. Il ne voudra jamais travailler et je travaille. Je suis stupide et il est malin. Je suis pratique et il est impossible. Il a peur et je suis stressé. Il est sentimental et je suis désabusé.

Pourtant, je crois vraiment qu’à un moment donné, j’ai été Paul Austère sans le savoir. Je ne pouvais le savoir parce que je ne le connaissais pas, je ne l’ai pas reconnu, mon corps, ma tête et mes jambes n’étaient pas assez forts pour le soutenir assez longtemps. Je ne l’ai été qu’un laps de temps très court. Peut-être quelques semaines, des mois au plus, entre le lycée et le début de l’université. Je n’en ai pas profité et ça a peu duré. Personne d’autre ne l’a vu sans doute. C’était une anomalie. Paul Austère n’existait pas avant : j’aimais le football, la télévision et les jeux vidéos. L’adolescence m’a transformé, quelque chose ou quelqu’un s’est retrouvé pris dans ce processus, coincé à ma place, en même temps que mon corps et mon esprit grandissaient et se transformaient. Depuis, lui ou une partie de lui n’ont jamais pu partir.
Pourtant, ce n’est pas lui qui vis ma vie aujourd’hui. Simplement parce qu’il serait mort. Le monde l’aurait tué ou il se serait sacrifié. Ce monde-là n’est pas fait pour ses envies, ses idéaux, ses rêves et sa façon de vivre. J’ai été forcé de prendre le contrôle. Je m’en excuse auprès de tout le monde. Lui me remercie parfois, me hait le reste du temps. Je ne lui demande pas de m’aimer. J’aimerai tant lui laisser ma place définitivement. Mais je sais que ça signifierait sa fin et je préfère l’entendre en moi, quitte à en crever, plutôt qu’il disparaisse. Il ne pourrait pas vivre dans un monde où il faut abandonner ses rêves et être réaliste, il ne pourrait communiquer avec sa bouche, ma bouche, et se faire comprendre des gens, même mal, il serait seul et triste avec le fardeau de supporter un corps, le faire vivre, se nourrir, se mouvoir et se maintenir.

Ma question est bien sûr de savoir si un jour je pourrai retrouver cet état de grâce où Paul Austère avait le contrôle sans que ni lui ni moi nous nous en rendions compte. Cette fois, tous les fruits de cette opération seraient récoltés parce que je me suis préparé à l’accueillir. De deux choses l’une : ou le monde change spécialement pour nous (la parution d’un roman qui marche un tant soit peu) ou bien nous arrivons à mettre en place un protocole de collaboration. Je prends le jour, il prend les nuits. Je prends les corvées, il prend la rêverie. Mais dans un tel cas, comment faire pour que nous ne contaminions pas l’un et l’autre et qu’au final nous nous retrouvions à échanger nos temps de présence sans le vouloir ?
Je repense à ces songes que je faisais en Première quand j’imaginais ce que pourrait être ma vie plus tard. Un boulot relativement régulier, un horaire fixe de sortie à partir duquel je pourrai écrire, créer, vivre. Est-ce possible ? Est-ce un bon compromis ? Tout ça n’est que dans ma tête, quand j’arriverai à fixer deux ou trois choses, faire un sorte que Paul Austère n’ai même plus conscience de la vie que je mène le jour, alors ce sera possible. Parce qu’actuellement, il regarde. Il regarde et ne peut rien faire pour m’aider parce que je l’ai caché dans mon esprit pour son propre bien. Il me regarde et prend pitié. Il me regarde et se bat pour sortir, ignorant qu’il y risquerait sa vie plus que la mienne.

Il me regarde comme nous regardons l’Homme au début de L’Aurore. Nous sommes sa propre conscience. Nous le voyons courbé, faible et cruel. Et puis il renaît. Qu’est-ce qui a bien pu changer ? Rien, absolument rien. Il a toujours ses dettes, sa maîtresse l’aime encore, la ville continue de le hanter. Rien n’a changé, sauf nous. Nous sommes là. C’est la magie du cinéma. Il ne faut pas plus de dix minutes, pas plus que le temps que nous nous plongions dans le film pour que en tant que conscience, nous le réveillons, le transformions, le ramenons dans le passé et lui rendions ce qu’il a perdu : son amour propre, son amour pour sa femme. Tout vient de lui. Elle l’aimait toujours même quand il était perdu. C’était simplement lui. Et nous l’avons aidé. Sur son épaule nous avons été bienveillant et tombant amoureux de sa femme, murmurant cet amour à son oreille, nous l’avons réveillé. Nous le faisons depuis plus d’un demi siècle et à chaque fois ça marche. Une fois associés à lui, nous sommes si fort que nous pouvons changer le cours du monde et toute notion de réel. Voilà la morale du film. Nous pouvons récupérer ce qui a été perdu. Reste à savoir si Paul Austère est aussi fort et puissant émotionnellement que l’ensemble des spectateurs qui tiennent dans la grande salle de La Filature.

Ou peut-être que vous pouvez oublier tout ce que je viens de dire. Peut-être que je suis simplement malade. Mentalement malade. J’ai trop d’imagination. Pas forcément pour inventer des choses inédites et époustouflantes mais au moins pour réinterpréter via l’écriture certains éléments existants. Et je me perds dans cette imagination. Je ne sais plus faire la différence entre ce qui s’est passé la vieille, ce qui se passera le lendemain et ce qui n’a jamais existé. Parfois je suis piégé en moi, je rencontre des fantômes de personnages, je crois imaginer des gens qui existent vraiment. Je me cogne contre les propres parois de mon cerveau. La maladie de l’imagination. La pire. Rien n’existe et pourtant tout existe. Une simple pensée peut tordre la réalité, la rendre monstrueuse ou splendide. Une simple pensée. Une simple pensée fait s’élever des châteaux et s’effondre des bâtisses. Il y a beaucoup de bons côtés, mais quand il y en a des mauvais, ils sont vraiment mauvais. De quoi souhaiter ne plus jamais être capable d’imaginer quoi que ce soit. De quoi modifier à jamais la réalité en pire. De quoi souhaiter mourir au plus vite. De souhaiter voir le noir, rien que le noir.

[La plupart du temps, j’apprécie les règles, mais il y a une chose que j’apprécie encore plus : les transgresser. Voilà pourquoi vous avez eu droit à un post qui porte sur ma personne. Je n’avais aucune autre idée. Et à partir du moment où c’est écrit, ça devient de la fiction.]

20 ans pour la dernière fois (heureusement)
Je pourrais poster. Vraiment, m'appliquer, recopier des trucs de mon carnet d'albion.Mais non. Pas possible. Trop de vide, presqu'un trou noir au milieu de mon torse. Où il disparait ou je disparais.
The Kills - Superstition (live)
The Smiths - The Queen Is Dead (live)
Cat Power - Cross bone style









